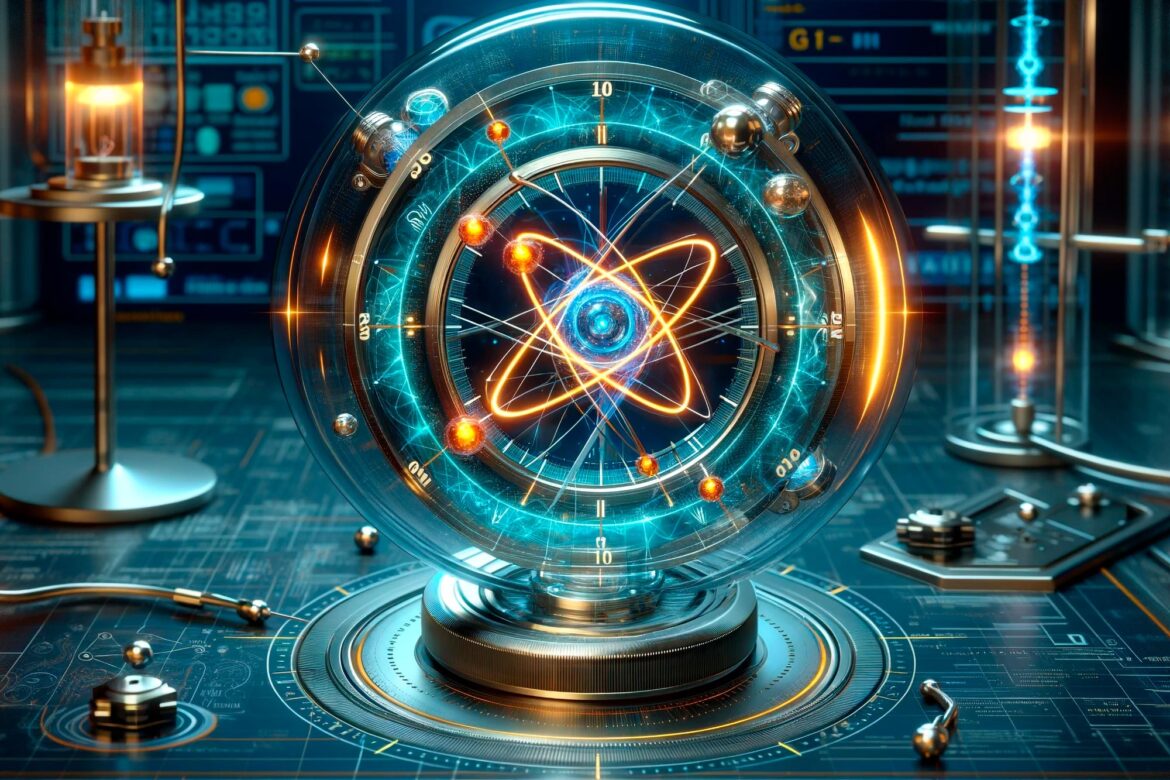Emplacements de l’horloge atomique
En Allemagne, quatre horloges atomiques sont en service. Elles se trouvent toutes à l’Institut fédéral de physique et de métrologie (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) à Brunswick.
- L’une d’entre elles, l’horloge au césium CS2, nous fournit l’heure exacte depuis 1991. Votre horloge radio-pilotée à la maison ou à votre poignet reçoit par exemple l’heure exacte de cette horloge atomique.
- Plusieurs horloges atomiques sont en service en Autriche. L’Office fédéral de métrologie et de géodésie, dont le siège est à Vienne, en est responsable.
- L’heure atomique TAI provient d’une horloge atomique située en Suisse. Le laboratoire de temps et de fréquence de l’Office fédéral de métrologie à Wabern, près de Berne, exploite également plusieurs horloges atomiques.
Ce qu’il faut savoir sur les horloges atomiques
Les horloges atomiques sont réputées pour leur grande précision. Cette mesure du temps est normalisée depuis 1967. L’unité de temps utilisée est la seconde.
- Une seconde correspond exactement à 9 192 631 770 oscillations micro-ondes du rayonnement césium. Ces oscillations sont à la base de nos horloges atomiques et de notre temps.
- Comme on peut s’y attendre, le fonctionnement d’une horloge atomique repose sur la physique, mais aussi sur la chimie. Les horloges atomiques actuelles utilisent l’isotope 133 du césium.
- Le fonctionnement lui-même est complexe. Pour simplifier, une horloge atomique, comme toute autre horloge, se compose d’un compteur et d’un générateur d’impulsions.
- Le césium sert de générateur d’impulsions dans l’horloge atomique. Il est d’abord vaporisé dans un four, puis concentré en un faisceau sous vide. Les atomes de césium se trouvent alors à l’état fondamental.
- Dans un champ magnétique à micro-ondes, les atomes changent d’état avec une certaine probabilité, puis sont comptés.
- Le champ à micro-ondes est réglé de manière à compter le plus grand nombre possible d’atomes. Cela correspond à 9 192 631 770 oscillations micro-ondes par seconde, comme mentionné ci-dessus.
- L’heure est si précise parce que la fréquence de rayonnement des transitions des atomes de césium est presque constante. Ainsi, l’horloge atomique de Brunswick n’a qu’un écart de 13 milliardièmes de seconde par an.
- D’ailleurs, l’horloge atomique n’existe pas seulement depuis la définition de l’unité de temps « seconde » en 1967.
- La première horloge atomique a été développée dès 1949, au National Bureau of Standards aux États-Unis. À l’époque, cependant, le générateur d’impulsions n’était pas encore constitué d’atomes de césium, mais de molécules d’ammoniac.
Pourquoi les horloges atomiques régissent notre vie
Sans les horloges atomiques, notre quotidien serait littéralement désorganisé. Bien qu’elles restent invisibles, de nombreux systèmes modernes dépendent directement de leur précision.
- Navigation GPS : les satellites calculent les distances à partir de différences de temps exactes. Un écart d’un milliardième de seconde suffirait à causer des erreurs de positionnement de plusieurs mètres.
- Télécommunications : les réseaux mobiles et les services Internet synchronisent les paquets de données via l’heure atomique.
- Réseau électrique : les fréquences du réseau et la répartition des charges reposent sur une synchronisation précise du temps.
- Marchés financiers : les bourses et les systèmes de négociation ont besoin d’horodatages précis à la milliseconde près pour les transactions.
La coordination internationale du temps par des horloges atomiques permet ainsi d’assurer l’ordre dans un monde numérique interconnecté.
Précision comparative : horloges atomiques, à quartz et mécaniques
Quelle est la précision réelle d’une horloge atomique et comment se comporte-t-elle par rapport à d’autres instruments de mesure du temps ?
- Une montre mécanique peut dévier de quelques secondes par jour, tandis qu’une montre à quartz ne perd que quelques secondes par mois. Une horloge atomique au césium, en revanche, ne perd même pas une seconde en un million d’années.
- Les horloges atomiques optiques modernes sont encore plus précises : elles mesurent à l’aide d’un rayon laser les oscillations d’atomes tels que le strontium ou l’ytterbium et atteignent une stabilité telle qu’elles ne dévieraient d’une seconde qu’au bout de plus de 30 milliards d’années.